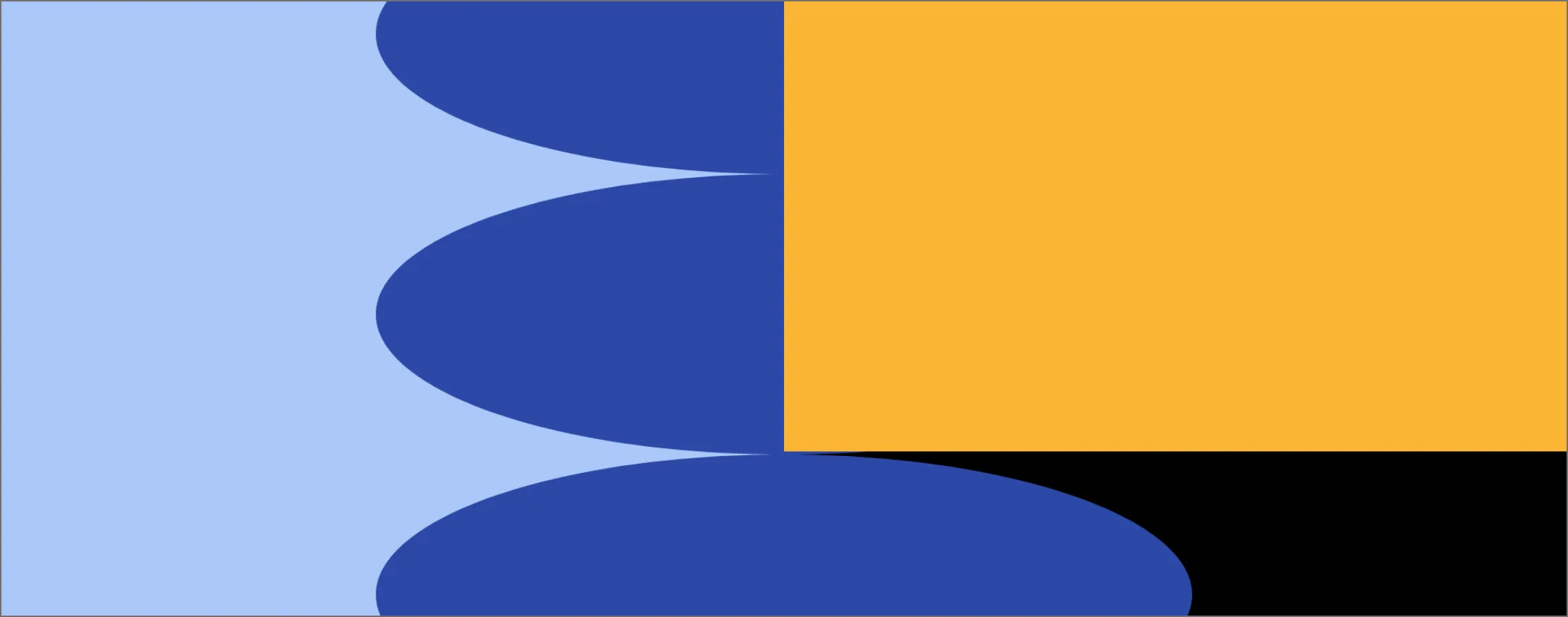Les glaciers, un thermomètre du climat qui s’emballe
« Être glaciologue, c’est être médecin des glaciers », explique Heïdi Sevestre. Son travail consiste à observer ces colosses de glace, à mesurer leur déclin et à alerter sur les bouleversements qu’ils annoncent. Depuis ses débuts il y a 400 000 ans, l’humanité n’a jamais connu une planète sans glace. Aujourd’hui pourtant, les glaciers de montagne – des Alpes à l’Himalaya – reculent dangereusement, mettant en péril l’accès à l’eau douce de près de 2 milliards de personnes. Mais le problème dépasse la fonte des neiges : les calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique, si elles venaient à disparaître, entraîneraient une élévation du niveau des mers de 65 mètres, et forçant des centaines de millions de personnes à se déplacer et impactant de ce fait l’ensemble du globe.
« Plus nous perdons de glace, plus les effets du réchauffement climatique s’emballent », avertit la scientifique. Car ces géants blancs jouent un rôle-clé dans la régulation des courants océaniques et des vents planétaires. Leur disparition accroît la fréquence et l’intensité des événements climatiques extrêmes, comme les canicules, les tempêtes ou les sécheresses prolongées.
L’urgence est d’autant plus prégnante que contrairement à une idée reçue, la fonte des glaciers ne suit pas une logique linéaire. « Il existe des points de bascule », insiste la glaciologue. Dépasser 1,5°C ou 2°C de réchauffement pendant plusieurs décennies (entre vingt et trente ans selon les dernières estimations) déclencherait des réactions en chaîne irréversibles, comme l’effondrement total du Groenland. Or, nous avons déjà atteint 1,3°C. « Ce que nous décidons aujourd’hui déterminera l’état du climat pour les siècles à venir », martèle-t-elle. L’enjeu est intergénérationnel : les choix actuels engagent le futur.
« Ce que nous décidons aujourd’hui déterminera l’état du climat pour les siècles à venir. »
Heïdi Sevestre, glaciologue
Des solutions à portée de main qui attendent un déclic politique
Si les constats sont alarmants, Heïdi Sevestre refuse de sombrer dans le pessimisme. « La situation devient catastrophique, mais les solutions existent déjà », affirme-t-elle. La priorité absolue ? Se libérer des énergies fossiles. Pourtant, malgré les COP successives, l’inaction politique reste un frein. « Tant que les décisions seront prises sur un consensus, tant qu’elles ne seront pas contraignantes, nous n’y arriverons pas », déplore-t-elle. Elle plaide pour une révolution dans la gouvernance climatique : « Il faut cesser de négocier notre propre disparition ».
Pourtant, des raisons d’espérer cette prise de conscience politique existent. Heïdi souligne l’émergence de nombreuses initiatives positives : « Ce qui me donne espoir, c’est ce qui se passe dans les territoires. Les actions locales se multiplient et montrent qu’une autre voie est possible. » Les villes adoptent des stratégies d’adaptation, les initiatives citoyennes fleurissent, et certains industriels commencent à s’engager activement dans la transition énergétique. « Nous devons transformer cette énergie locale en un mouvement global », insiste la scientifique. Seule une stratégie forte et concertée peut empêcher la catastrophe.

« Tant que les décisions seront prises sur un consensus, tant qu’elles ne seront pas contraignantes, nous n’y arriverons pas. Il faut cesser de négocier notre propre disparition »
Heïdi Sevestre, glaciologue
Une mobilisation collective nécessaire
Heïdi Sevestre en est convaincue : la transition écologique ne viendra pas uniquement des gouvernements. « C’est la solidarité entre les populations qui va faire la différence », insiste-t-elle. Elle appelle à une implication massive de tous les acteurs : citoyens, industriels, et surtout, des jeunes générations. « Chaque élection, chaque voix comptent. L’avenir dépend de notre engagement. » L’éducation est l’un des leviers fondamentaux de cette mobilisation. « Mon rôle ne se limite pas à la recherche scientifique. J’ai une responsabilité de transmission », explique-t-elle.
C’est pourquoi elle multiplie les interventions auprès des écoles, des collectivités et des institutions, pour partager son expertise et inspirer l’action, mais aussi les expéditions comme celles qu’elle mène sur les glaciers tropicaux depuis 2019. En Ouganda, elle collabore ainsi avec des experts locaux et l’UNESCO pour documenter ces écosystèmes uniques, souvent négligés par la communauté scientifique. « Ces glaciers ont une importance culturelle et écologique incroyable », souligne-t-elle. Ses expéditions ne sont pas seulement scientifiques : elles sont aussi politiques et symboliques. « Aller sur le terrain, c’est montrer que ces réalités ne sont pas abstraites. C’est mettre un visage humain sur la crise climatique. »
L’urgence d’un alignement global
Il ne s’agit donc pas seulement de changer nos habitudes individuelles, mais de repenser l’ensemble du modèle économique et énergétique. « Seule une stratégie forte et concertée peut empêcher la catastrophe. » explique Heïdi.
Alors que la dernière COP29, à laquelle elle a participé, s’est tenue à Bakou en novembre 2024, la glaciologue rappelle l’importance de ces conférences internationales. « Elles sont imparfaites, mais elles restent essentielles. C’est le seul moment de l’année où les pays se réunissent pour parler climat. » Elle salue l’accent mis sur la finance climatique, un levier essentiel pour accélérer la transition. Mais elle met en garde contre les fausses bonnes solutions comme certaines proposées par la géo-ingénierie, qui pourraient aggraver la situation au lieu de la résoudre. Le défi est immense, mais l’espoir subsiste. « Nous savons ce qu’il faut faire. Nous avons les outils. Il ne manque que la volonté. » Alors que le monde approche d’un point de non-retour, la glaciologue exhorte chacun à agir sans attendre : « Il n’est pas trop tard. Mais chaque jour compte. »