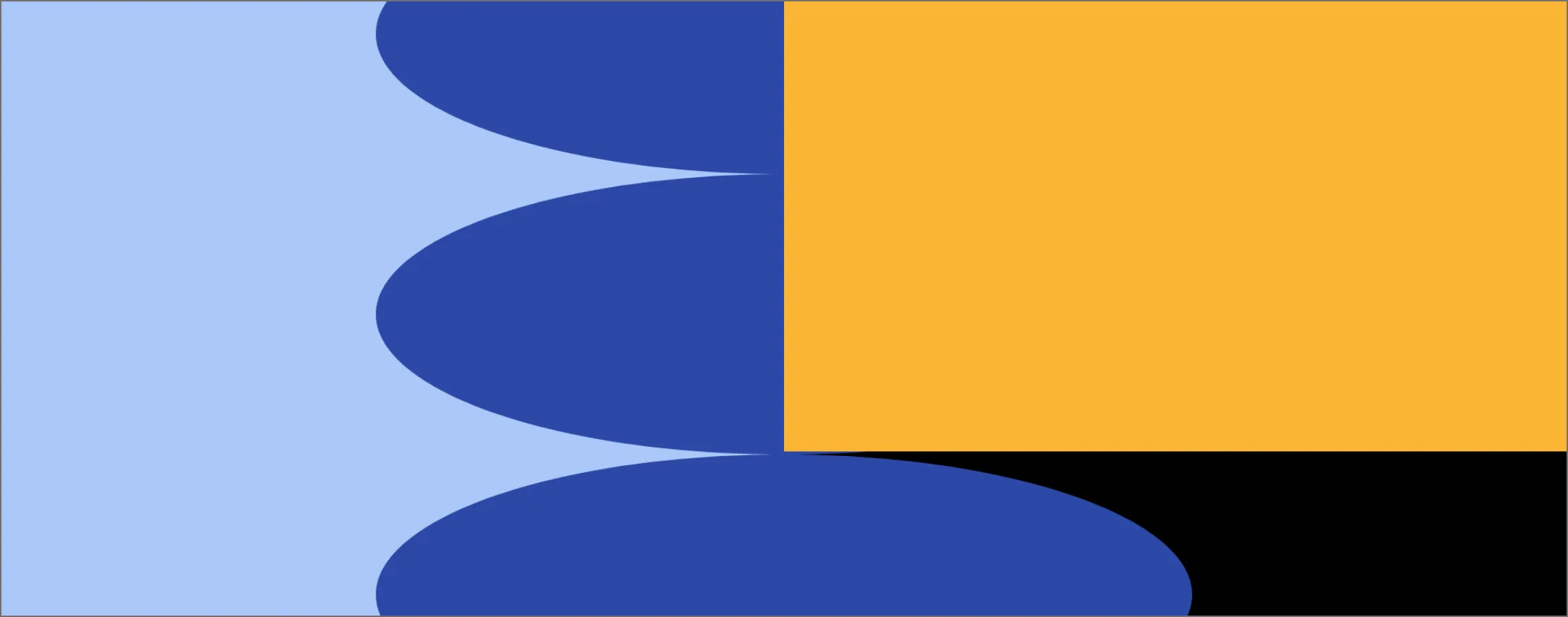Pourquoi avoir dirigé le projet de votre think tank vers l’éducation ?
Tout simplement car c’est le sujet majeur des prochaines décennies et qu’il ne me semble pas traité au regard des enjeux qu’il soulève. Le modèle éducatif d’une société est le témoignage de son dynamisme et de sa capacité de transformation. Il est temps d’accepter les diagnostics, d’évacuer toutes les idées reçues, d’avoir une approche globale et de considérer, le cas échéant, les adaptations nécessaires avec courage et ouverture de vue.
Existe-t-il une inégalité territoriale en matière d’éducation aujourd’hui ?
Les zones rurales sont le talon d’Achille du système éducatif. Les problématiques majeures sont la mobilité et l’offre très disparate avec des systèmes de spécialisation ou d’options qui sont autant d’atouts potentiels non exploités pour la scolarité des enfants. Nous retrouvons les mêmes écueils pour l’offre périscolaire.
Il est aujourd’hui indispensable d’adapter le système aux réalités locales. Les mesures qui pourraient être prises à court-terme sont notamment le rapprochement entre le scolaire et le périscolaire ainsi que le développement de politiques de soutien aux parents. Dans la Nièvre, les Hautes-Alpes ou l’Ouest, des projets de pôles éducatifs ont d’ailleurs émergé sous la forme de politiques unifiées. Cela suppose l’émergence de compétences complémentaires au niveau des collectivités locales.
Ces pôles éducatifs locaux sont-ils un levier pour impliquer davantage les parents des milieux moins favorisés ?
Il est urgent de leur apporter des clés. L’opération « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE), lancée par le ministère de l’Intérieur et celui de l’Education nationale à destination des parents allophones, cherche à favoriser l’insertion de ces familles en impliquant les parents dans la scolarité de leurs enfants. Ce projet a par exemple permis d’améliorer de façon immédiate la relation entre les parents et les enseignants.
Nous avons besoin d’une société vivante, responsable, capable de prendre des initiatives et de les endosser grâce un arbitre régulateur qui inspire la confiance. Il nous faut un projet éducatif qui soit le lien de la citoyenneté car l’éducation est le sujet numéro un d’une démocratie participative.
Les efforts que vous évoquez pour les pôles éducatifs sont à budget global constant ?
L’ensemble des dépenses d’éducation provenant de l’Education nationale, des collectivités ou des parents, des entreprises et des associations s’élève environ à 150 milliards d’euros par an dont 70 milliards sont mis en œuvre par l’État. Dans le cas du primaire, par exemple, les collectivités assurent 50% des dépenses. L’État reste un acteur parmi d’autres et le rôle des maires s’avère ainsi extrêmement important en matière d’éducation. Une augmentation des responsabilités des collectivités est nécessaire car ces dernières possèdent déjà les compétences. Les centres éducatifs deviendraient ainsi, à juste titre, des marqueurs d’attractivité territoriale à l’image des écoles dans le supérieur. L’émergence d’initiatives privées gagnerait ici en pertinence pour créer une émulation collective.
Les contenus des enseignements sont indissociables d’un projet éducatif ? Comment les décliner dans ces centres éducatifs ? L’universalité restera-t-elle la règle ?
Le contenu d’enseignement se décline de façon très diverse et varie selon le degré d’autonomie et du projet pour l’enfant. Si nous prenons l’exemple du débat sur le lycée professionnel, nous opposons trop souvent les enseignements généraux comme les maths et le français à l’apprentissage. Est-ce pour autant si incompatible ?
L’enseignement est un outil au service d’un projet éducatif. Aujourd’hui, nous avons tendance à penser les enseignements sans projet ni cohérence globale. Au primaire par exemple, il est question d’apprendre aux enfants les fondamentaux mais aussi de consolider leur capacité à s’intéresser au monde, gagner en confiance en soi et s’inscrire dans un collectif.
« L’enfant a besoin d’être entouré d’une pluralité d’adultes car la vérité est symphonique et l’éducation l’est aussi. »
De nos jours, chacun devient soliste, il nous manque à la fois un chef d’orchestre et une partition qui nous guide collectivement. Donc pour répondre à votre question, il restera bien sûr un corpus universel avec des spécificités locales défendues par les territoires eux-mêmes. Pas si loin de ce qui existe au fond mais avec plus d’agilité et de liberté.
La France n’a pourtant jamais été très à l’aise avec une décentralisation du système éducatif. Pensez-vous que ce projet soit réaliste ?
Cela ne pourra pourtant se faire que par le local car il est au plus proche de la réalité. Les prochaines élections municipales pourraient par exemple placer le sujet éducatif au premier plan.
Dans cet effort, nous prenons notre part et afin de mettre en avant le concret, le quotidien et de l’inscrire dans une dimension collective, Vers le haut travaille sur un nouveau sujet : « Le sport peut-il sauver l’éducation ? ». Le sport porte en effet des caractéristiques qui répondent assez précisément aux enjeux éducatifs car l’éducation n’est plus tant une question d’instruction mais plutôt de réinscription dans un environnement.
Le projet libéral d’un individu maître de son destin ne doit pas occulter le fait que tous les individus n’aient pas les mêmes leviers ni les mêmes qualités. Il nous faut tenir cet équilibre fragile entre transmission, émancipation, universalité et particularisme.