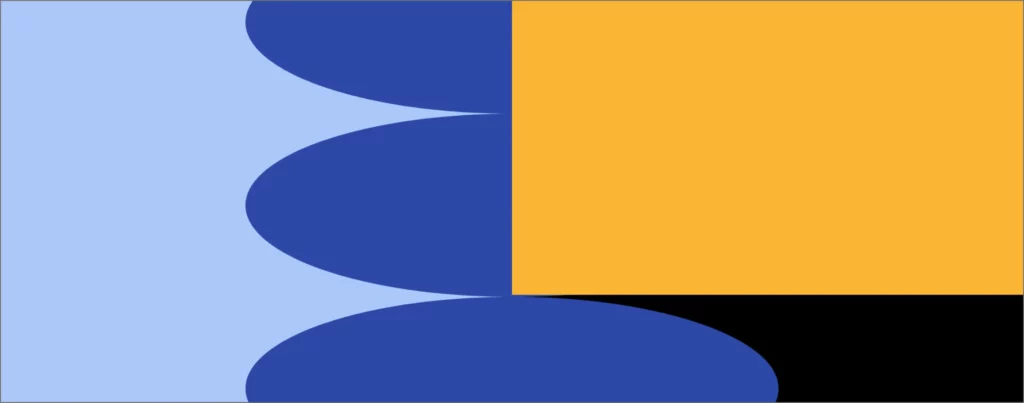L’Europe peut-elle encore avoir voix au chapitre dans la résolution du conflit en Ukraine ?
Florent Parmentier
Pour être à la table des négociations, il faut être en mesure d’inverser le rapport de force ou bien de proposer des solutions concrètes pour mettre fin au conflit. Or, il semble que l’Europe, pour l’heure, ne dispose ni d’un plan de guerre, ni d’un plan de paix, en vue d’un état final recherché.
Aujourd’hui, la marge de manœuvre des Européens est plutôt ténue. Le seul que l’on a pu voir tenter de tenir le rôle de négociateur c’est Viktor Orban. Le président hongrois avait en effet essayé d’œuvrer lors de la présidence hongroise en ce sens en activant son réseau au niveau des conservateurs américains et ses relations avec Vladimir Poutine. Seulement, sa position n’était pas partagée par les Européens.
Côté rapport de force, la Pologne a fait un effort énorme de réarmement (allant vers 5% du PIB). Mais sa posture, fondée en grande partie sur le bouclier américain, ne fonctionne plus aussi bien aujourd’hui.
Le constat est donc que l’Europe n’est pas en position de force ; elle est même tombée dans une impasse.
Cyrille Bret
L’Europe doit et peut avoir voix au chapitre. Il faut rappeler que ce qui s’est engagé ce sont seulement des pourparlers préliminaires de cessez-le-feu. Le chemin est long de ces pourparlers à un traité de paix en passant par un armistice.
C’est un scandale juridique que les discussions se déroulent sans les Ukrainiens et un scandale géopolitique qu’elles aient lieu sans les Européens. Toutefois, lorsque l’on va entrer dans l’élaboration d’un accord d’armistice et d’un traité de paix, la seule garantie de la Russie et des États-Unis ne va pas suffire à une paix stable. Au moment de signer un éventuel accord de paix, l’Ukraine va nécessairement se tourner vers l’Europe en guise de garantie. Notamment parce que les Etats-Unis ne voudront pas la donner.
C’est aux Européens de demander inlassablement de prendre part aux négociations, au nom de ce qu’ils ont fait jusqu’alors mais aussi comme gage de la sécurité de leur propre continent et de la reconstruction de l’Ukraine. La stratégie des sanctions est un levier tactique dans l’inversion du rapport de force avec la Russie. Les Européens doivent faire savoir qu’ils ne mettront fin à aucune sanction tant qu’ils ne seront pas à la table des négociations.
Il convient aussi d’engager un rapport de force avec les États-Unis. Si les Américains ont pour objectif de faire reconstruire l’Ukraine avec des fonds européens, ils doivent permettre à l’Europe d’être un acteur des négociations. Il convient de tenir le rapport de force : pas de financement européen sans association aux négociations.
Aucun État ne peut donner procuration à un autre pour redessiner ses frontières, encore moins quand il s’agit d’un allié. L’Ukraine est traitée comme les vaincus. Autrement dit, elle n’est pas présente dans la salle des négociations mais elle est convoquée pour signer. C’est une situation assez inédite. Même la France avait pu participer aux négociations du Congrès de Vienne après les guerres napoléoniennes… Les Etats-Unis traitent l’Ukraine en pays vaincu : ils ne l’associent pas aux discussions, exigent des remboursements de guerre et veulent une obéissance immédiate. L’administration Trump II va réaliser ce que la Russie voulait : une Ukraine démilitarisée, au gouvernement changé et à la neutralité forcée.
La conférence de Munich va-t-elle durablement ternir la relation entre Européens et Américains ?
Cyrille Bret
La guerre douanière est un conflit économique déclenché par Trump contre l’Europe. L’initiative de pourparlers directs avec la Russie est une guerre ouverte sur le plan stratégique contre l’OTAN. Le discours de JD Vance est une croisade idéologique contre l’Europe fondée sur l’ignorance et le mépris de ce qu’elle est. Ceci au moyen d’une déformation des faits et de fake news. Le vice-président américain a déshonoré son office en se prononçant de façon explicite contre des valeurs fondamentales sur lesquelles convergent historiquement l’Europe et les États-Unis, par-delà l’Atlantique et les intérêts géopolitiques.
Cela va ternir durablement les relations entre Européens et Américains. De facto, cette situation constitue aussi une grande opportunité pour les Européens sur la scène mondiale. Désormais, ils sont les seuls à défendre le pluralisme, l’équilibre des pouvoirs, l’État de droit, le respect des droits individuels et des minorités. A eux de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Le rôle de leader du monde libre est aujourd’hui laissé vacant : que les Européens s’en saisissent !
Florent Parmentier
La conférence de Munich est un sommet de référence dédié aux questions de sécurité. C’est dans ce cadre que Vladimir Poutine avait interpellé de façon assez hostile les Américains, ainsi que les Européens, en 2007. Il avait alors parlé de stratégie dans un lieu pourtant pensé pour évoquer la chose sécuritaire.
De son côté, JD Vance s’est servi de cette conférence comme d’une tribune pour évoquer des questions identitaires et politiques, loin de toute considération sécuritaire. Affirmer que la Commission européenne est un ennemi pour les Européens qui est bien pire que Poutine, c’est une prise de position politique. JD Vance s’est aussi illustré par des propos inconséquents, notamment lorsqu’il a reproché à l’Allemagne de se désindustrialiser alors même que les États-Unis ont saboté le gazoduc Nord Stream II.
Peut-on imaginer une résolution du conflit entre Russes et Ukrainiens ces prochaines semaines ?
Florent Parmentier
Tout dépend de la forme que prend cette résolution. Il peut y avoir une interruption du conflit, une résolution bâclée ou alors une fin de la guerre adossée à un plan de paix solide.
Côté ukrainien, le front ne s’effondre pas même s’il est sous pression à de multiples endroits. Ce qui est sûr c’est que l’effort de guerre réalisé a fragilisé l’Ukraine. On ne peut exclure une forme d’effondrement localisée du front. Cela pourrait se produire dans plusieurs mois, dans des années, voire jamais. L’ancien chef d’état-major de l’Ukraine, Valeri Zaloujny, avait de son propre aveu indiqué qu’il serait difficile de faire bouger le front.
L’évolution du conflit va également dépendre de la situation politique de l’Ukraine. On peut supposer que les États-Unis auront intérêt à ce qu’un nouveau président soit élu, et vont pousser en ce sens, afin qu’ils puissent lui imposer des conditions drastiques de sortie du conflit.
Ce qui va jouer aussi c’est la poursuite ou non de livraisons d’armes à destination de l’Ukraine.
Une seule certitude, il sera possible de s’accorder sur un cessez-le-feu si les protagonistes y trouvent un intérêt. Si d’aventure cela se produit, il faudra respecter ce cessez-le-feu et l’accord conclu. Chacun se souvient que les accords de Minsk n’avaient été respectés par aucune des parties…
Cyrille Bret
Une véritable résolution du conflit n’est pas envisageable à court-terme. On peut éventuellement imaginer une suspension limitée des échanges armées, et encore… Cela est attesté par le fait qu’un cessez le feu maritime et aérien est aujourd’hui en discussion.
N’oublions pas que l’enjeu du conflit est structurel pour les belligérants. Pour les Ukrainiens, l’enjeu est la récupération de 20 % de leur territoire, la capacité à mener une politique extérieure autonome, et la préservation de leur identité nationale.
Pour la Russie, l’enjeu est sa crédibilité internationale et sa capacité à peser sur les destinées de l’Europe centrale et orientale.
La résolution du conflit bilatéral est complexe et résultera d’un processus long. Les prochaines semaines de discussions ne permettront pas d’obtenir cette résolution. La paix bâclée trompétée par Trump depuis quelques semaines est très loin d’un traité. Les Européens le savent et ils ont une carte à jouer.
Le traité bilatéral de paix exige de nombreuses concessions que seules des discussions prolongées permettront. Et des traités bilatéraux de réassurance entre l’Ukraine et certains de ses soutiens occidentaux seront nécessaires. Le chemin est long mais il peut commencer sous peu.