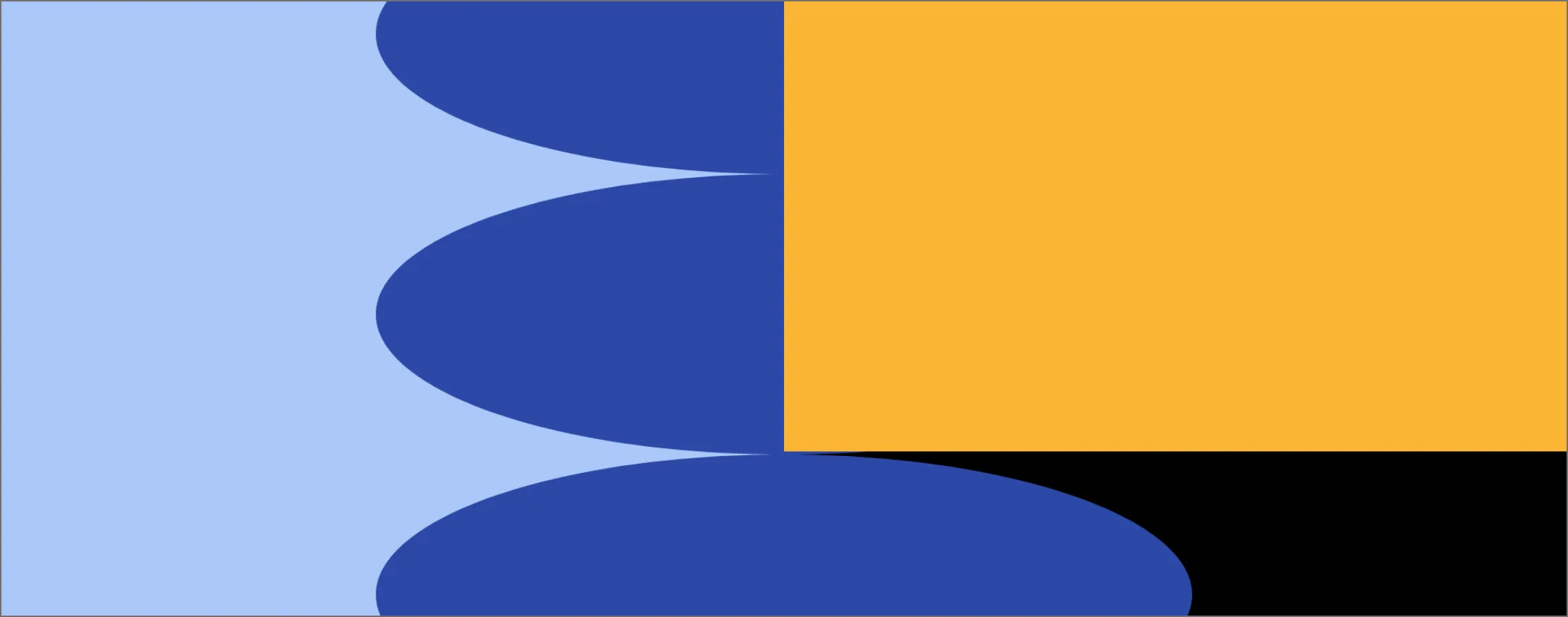Votre essai s’intitule “Une société désirable”. Selon-vous, comment définir une telle société dans un contexte de crises multiples ?
Si nous voulons convaincre nos concitoyen·nes de l’absolue nécessité d’engager nos sociétés dans la reconversion écologique, on doit leur montrer pourquoi et en quoi cette situation sera pour eux plus désirable. J’essaye ainsi de tenir compte des critiques adressées à celles et ceux qui rappellent que le changement écologique est une menace vitale, et auxquels on reproche d’être punitifs voire liberticides. J’essaye de montrer qu’en effet il nous faut peut-être changer de registre. Je suis certaine qu’il faut que nous soyons capables d’expliquer que les conditions de vie dans une telle société seront meilleures pour chacune et chacun en ce qui concerne tant la santé, que l’alimentation, les liens sociaux, la beauté, le travail, l’emploi… Une société désirable, c’est celle dans laquelle les besoins essentiels de tous les individus sont satisfaits, et qui assure à toutes et tous un horizon de paix et de prospérité (reste évidemment à définir ce dernier terme qui n’est pas synonyme d’enrichissement).
Depuis le rapport Meadows de 1972, l’alerte écologique est documentée. Pourtant, nos modes de vie restent toujours incompatibles avec les ressources limitées de notre planète. Pourquoi une telle inertie collective ?
Les obstacles sur la route de la reconversion écologique sont légion. Retour du climatoscepticisme – désormais qualifié de climato-réalisme, travail des marchands de doute et de tous ceux qui risquent de perdre à la transition, peur des plus riches de devoir revoir leur niveau de vie, crainte des plus modestes de ne pas avoir de solution de rechange, pendant longtemps action de certain.es économistes pour laisser penser que la technologie nous sauverait… Mais il faut aussi reconnaître la difficulté de la situation : pour avancer vraiment il faudrait une action internationale concertée ou au moins une action européenne déterminée. Mais le fait qu’un certain nombre de pays n’aillent pas dans la bonne direction représente une forme de dumping qui décourage les plus vertueux. Enfin, c’est aussi difficile parce qu’une telle transformation exige une planification sans faille pour organiser simultanément des investissements massifs, une reconversion des emplois, une redistribution du revenu national.
Comment expliquez-vous que certains États, face à l’incertitude, se tournent de plus en plus vers des modèles autoritaires ?
C’est la très mauvaise nouvelle de ces dernières années : l’extrême-droite a décidé de faire de la transition écologique son bouc émissaire en remettant en cause toutes les mesures qui visent à faire reculer l’usage des énergies fossiles et à promouvoir la reconversion écologique et à attirer ainsi vers elle une partie de celles et ceux qui sont en colère. Elle dénonce aussi l’UE c’est-à-dire la seule chance que nous avons d’organiser à une échelle pertinente la transformation de nos économies. Nous avons vu cela avec les inondations dans le Nord : à mesure que les catastrophes se développent, la colère monte et s’adresse au gouvernement en place qui n’aurait pas été capable de prévoir et de prévenir. Nos concitoyen·nes ont l’impression d’une impuissance publique et accordent malheureusement leur confiance à celles et ceux qui n’ont jamais gouverné et leur font des promesses illusoires. Il faut lire le programme de Marine Le Pen sur l’environnement pour l’élection présidentielle de 2022 : beaucoup de promesses mais absolument rien de concret, sans compter le caractère irresponsable de la proposition votée par LR et Le RN de faire un moratoire sur les énergies renouvelables.
L’éco-anxiété touche aujourd’hui une part croissante de la jeunesse. Ce phénomène est-il pour vous un symptôme inquiétant de mal-être ou davantage un signal d’alarme porteur d’espoir ?
C’est un symptôme très inquiétant car au lieu de pousser à l’action il anesthésie les individus. Pour agir, il faut penser que nous avons un minimum de chances de changer les choses, qu’il existe un petit espace pour transformer la réalité. Or, plus le temps passe, plus les renoncements sont nombreux, plus l’éco anxiété grandit.
Quel rôle ce choc générationnel peut-il jouer dans le changement politique ? Les seniors pourront-ils trouver facilement leur place dans ce changement de société ?
Il fut un temps où les jeunes constituaient une véritable force notamment parce que les plus âgé·es craignaient leur révolte. Aujourd’hui il n’est plus question de cela. Les retours en arrière sont tels que la jeune génération semble tétanisée et d’une certaine manière résignée.
Quant aux plus âgé·es, je pense que leur état d’esprit dépend beaucoup de la question de savoir s’ils ont des enfants ou des petits-enfants. Je crains énormément le raisonnement « après moi le déluge ». Je ne sens pas aujourd’hui de volonté forte de la part d’une classe d’âge ou d’une génération de changer radicalement la marche des choses.
Dans une étude récente menée par BVA pour l’ISC Paris, les 18-24 ans placent la rémunération et l’ambiance de travail loin devant les engagements RSE comme choix de “job de rêve”. N’est-ce pas paradoxal compte tenu de l’éco-anxiété à laquelle elles et ils sont par ailleurs sujets ? Est-ce une génération incohérente ou clivée ?
C’est très difficile pour les jeunes, qui sont maltraité·es et ne représentent pas le cœur des projets politiques, de forger un idéal commun partagé. Depuis que les enquêtes existent, les jeunes ont toujours placé le travail et surtout le fait d’avoir un travail intéressant, utile et une bonne ambiance de travail parmi leurs priorités. Un certain nombre aimeraient précisément que leur travail permette de réparer le monde plutôt que de continuer à le détruire. Mais ces dernier·es ne constituent pas une partie assez influente de la population, elles et ils sont de plus en plus résignés. Nous savons que beaucoup, parmi les partis politiques, tentent plutôt de séduire les seniors qui votent plus que les jeunes…
Vos travaux reposent sur la nécessité de repenser la place du travail dans nos vies. En quoi notre modèle productiviste actuel est-il incompatible avec la transition vers une société durable ? Le travail peut-il encore être un vecteur de sens collectif et personnel, ou faut-il apprendre à penser l’épanouissement en dehors de la sphère professionnelle ?
Ce que toutes les enquêtes montrent c’est que les jeunes et les moins jeunes continuent de placer leurs espoirs dans le fait que le travail pourrait être un vecteur de sens collectif et personnel. Les jeunes veulent un travail intéressant, utile, et donc susceptible de contribuer au changement social nécessaire. Mais à mesure que leurs espoirs sont déçus et que se déploie une forme de désillusion très forte, on risque de voir les espoirs de réalisation de soi se porter hors du travail.
A ce titre, pourrait-on imaginer un nouveau modèle autour du travail ? Quelle en serait sa forme ?
Il me semble que plus que jamais le travail pourrait être le support du changement que nos sociétés doivent organiser. La transformation que nous devons engager est massive. Elle concerne tous les secteurs. Elle nécessite la contribution de toutes les bonnes volontés. On a besoin de planificateur·ices, ingénieur·es, chef·fes d’orchestre, conseiller·es, recycleur·euses, agriculteur·ices, rénovateur·ices…bref de toutes les compétences variées pour organiser la bifurcation écologique de nos sociétés.
C’est un chantier gigantesque qui, si nous étions capables de l’engager, pourrait enthousiasmer toutes les générations. Il faut relire le plan de programmation des emplois et des compétences de 2019, rédigée par l’équipe animée par Laurence Parisot, et la publication du SGPE de juillet 2024 pour prendre la mesure de l’énormité du chantier à ouvrir.
La transition écologique n’est pas seulement technique ou économique, elle est selon vous culturelle, sociale et politique. Concrètement, que signifie ce changement de modèle ? Avez-vous des modèles inspirants à nous partager ? (En France ou à l’étranger)
Concrètement cela signifie consommer de moins grandes quantités de biens et services, éradiquer l’usage des énergies fossiles, passer à une agriculture largement bio, relocaliser une partie de notre production et donc sans doute avoir besoin de plus de travail humain (moins de pesticides, moins d’adjuvants chimiques, moins d’aides mécaniques). Le vice-président de la Commission européenne, Sicco Mansholt, dans sa Lettre de 1972 avait parfaitement décrit cela, sous la forme d’un court programme de bifurcation écologique dont l’actualité est criante.
Aujourd’hui, il me semble qu’un pays comme le Danemark est sur cette voie. Les danois·es – bien qu’étant en pointe en matière d’éoliennes, de recyclage, d’entreprises responsables, de priorité au vélo – n’ont pas l’air trop malheureuses ni malheureux : d’après les palmarès c’est même un des pays le plus heureux au monde…
Comment assurer une transition juste pour toutes les catégories de population ?
Si nous voulons éviter ce qui s’est passé avec les Gilets jaunes, il nous faut connaître avec la plus grande précision les conditions de vie des personnes, ne prendre aucune décision qui ne soit anticipée et accompagnée financièrement ou qui ne permette pas aux personnes d’accéder à des alternatives. C’est pour cela que le changement est tellement compliqué. Il nous faut mettre à contribution tout le monde de façon proportionnée et permettre à chacun de visibiliser les avantages à attendre du changement. C’est particulièrement vrai en matière de transport et d’emploi.
Quelles sont les conditions pour que cette société désirable devienne une trajectoire politique et sociale crédible et réalisable plutôt qu’une utopie ? Quels leviers selon-vous faudrait-il activer en priorité ?
Comme le suggérait le vice président de la Commission européenne en 1972, il faut d’abord précisément fixer une trajectoire, arrêter un plan qui fixe les objectifs de réduction des émissions de GES de la manière la plus fine possible mais aussi de transformation des emplois, de relocalisation, d’aménagement des territoires, de financement des infrastructures…Il faut planifier. Mansholt proposait une planification européenne articulée avec les planifications nationales, cela me semble toujours d’actualité.
Quel rôle les citoyen·nes, mais aussi les syndicats, les enseignant·es, les médias, et bien sûr les politiques ont-ils à jouer dans cette quête ?
Tout le monde a un rôle éminent à jouer ! Nous devons empêcher les réactionnaires de faire obstacle à cette transition qui est urgente. Tout le monde doit participer pour que cela devienne un enjeu national et une sorte d’impératif national où chacun a sa partition à jouer.