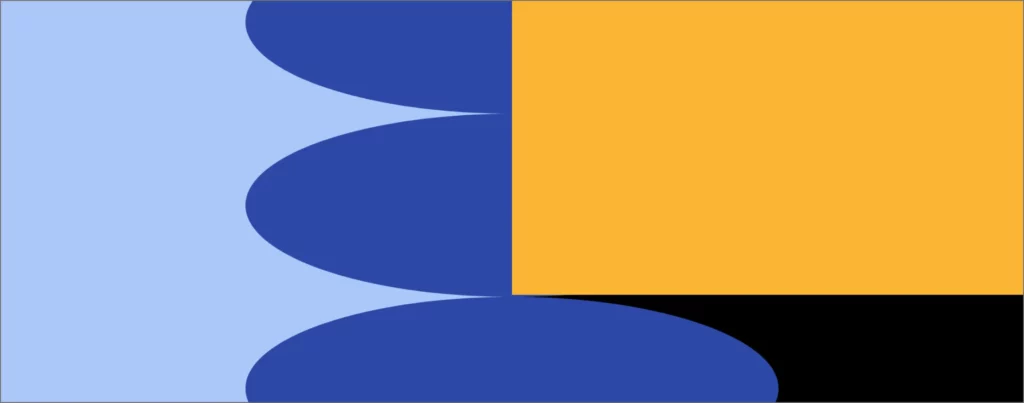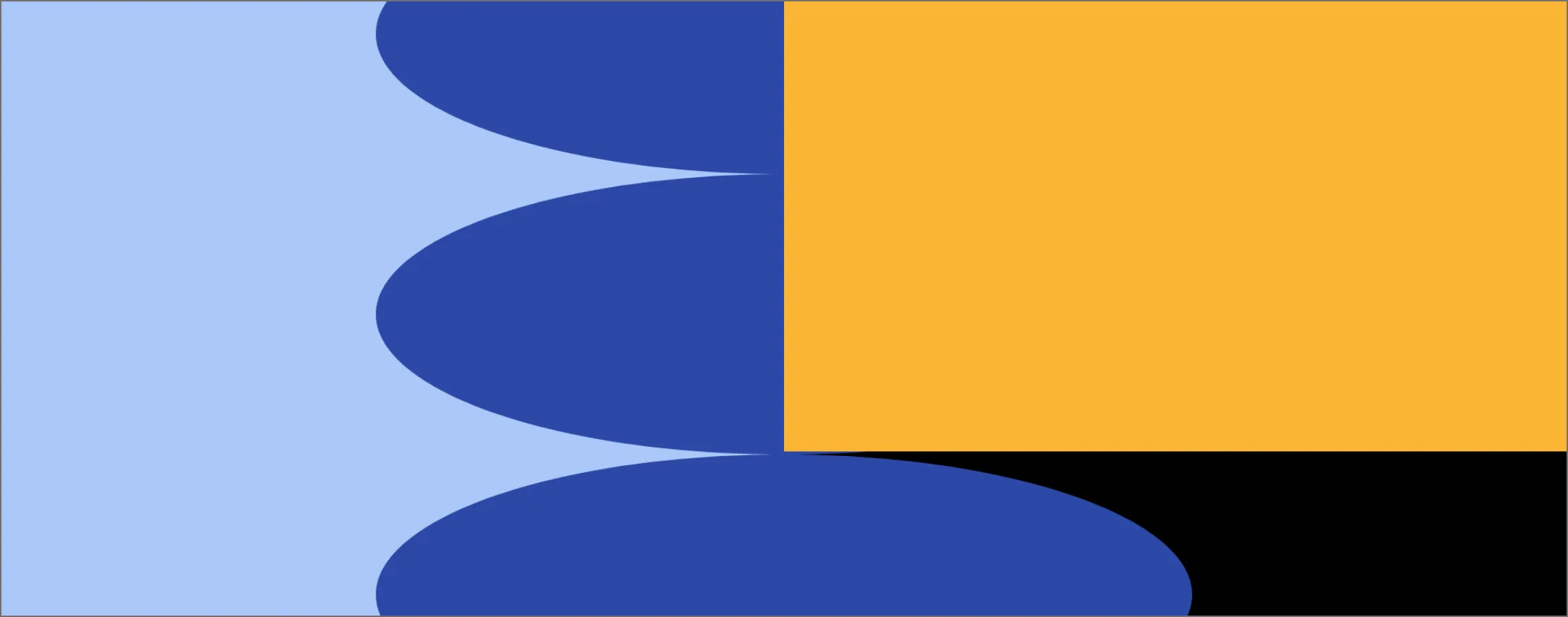Quelle est l’influence réelle des Américains sur ce conflit ? Sans l’affirmer clairement, les États-Unis sont-ils dans une logique de belligérance ?
L’objectif est d’affaiblir la Russie en Europe : en Europe du Nord avec l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan mais aussi à travers le soutien apporté aux États baltes et à la Géorgie dans le Caucase. Il s’agit là d’une logique de belligérance par procuration qui passe par la livraison d’armes, l’envoi d’instructeurs sur le sol ukrainien, etc. C’est donc la reprise de tactiques qui avaient cours durant la Guerre froide.
Cette stratégie découle du fait que les États-Unis ne veulent plus s’engager directement dans des conflits après les expéditions en Afghanistan et en Irak engagées respectivement en 2001 et en 2003. Sans compter qu’aujourd’hui, la rivalité avec la Chine importe davantage aux Etats-Unis.
La Biélorussie pourrait-elle être amenée à jouer un rôle dans ce conflit ?
La position de la Biélorussie est tout à fait particulière. Comme l’Ukraine, c’est une ancienne République socialiste soviétique. C’est un État indépendant depuis 1991 dont l’identité nationale est peu respectée par le pouvoir russe. C’est un État exposé aux mêmes risques que l’Ukraine. Mais à la différence de cette dernière, la Biélorussie a réussi à entretenir depuis 1991 des relations plus ambiguës avec la Russie. Le dictateur Loukachenko a essayé de se présenter comme un partenaire fréquentable aux yeux des Occidentaux tout en donnant des gages à la Russie.
La Biélorussie voit sa marge d’action réduite depuis les élections truquées de l’été 2020. Elle vit une indépendance précaire. Elle ne doit pas froisser le Kremlin, assurance vie politique du régime, tout en évitant de rentrer en guerre avec l’Ukraine. L’équilibre est fragile. Je ne vois pas pour l’instant comment la Biélorussie pourrait entrer en guerre mais il faut rester prudent car, dans ce conflit, la situation évolue rapidement.
Le risque nucléaire est-il à prendre au sérieux ?
Ce risque est à prendre au sérieux d’une part pour une raison de doctrine. Depuis longtemps, les forces armées russes ont refusé d’exclure un usage des armes nucléaires sur le champ de bataille, c’est ce qu’on a appelé le nucléaire tactique. D’autre part, cette menace doit être prise au sérieux pour des raisons qui sont conjoncturelles : ce conflit met en jeu la crédibilité et la stabilité du régime politique russe. Sans une victoire nette en Ukraine, le régime pourrait être remis en cause par l’opposition libérale et par les partis nationalistes. Poutine est donc condamné à la victoire. S’il voit qu’il ne peut pas l’emporter par des moyens conventionnels, il mettra toutes les options sur la table, y compris l’usage du nucléaire.
Certains observateurs soulignent que l’Ukraine est une première étape et que la Russie risque d’envahir d’autres États. Cette crainte est-elle fondée ?
Oui. La Russie a toujours prévenu qu’elle s’opposait à l’expansion de l’OTAN en Europe du Nord et dans le Caucase, la candidature répétée de la Géorgie étant particulièrement inacceptable pour elle. Le statut particulier de la Moldavie pose également problème, pays dont une grande partie de la population est russe. Cela pourrait donner prétexte à une intervention de la même nature que celle qui a lieu en Ukraine.
La situation pourrait donner lieu à des débordements mais pas dans l’immédiat. L’appareil militaire et politique russe est concentré sur l’obtention de gains territoriaux et stratégiques en Ukraine. Or, pour le moment, la victoire est loin d’être acquise…
La Russie fait l’objet de sanctions lourdes depuis plusieurs mois. Poutine peut-il redouter une érosion du soutien de l’opinion publique russe ?
Pour l’immense majorité de la population russe, le responsable de ces sanctions n’est pas la politique extérieure russe mais bien l’hostilité systématique de l’Occident. D’une certaine manière, plus les sanctions sont dures plus cela justifie la paranoïa russe envers l’Occident.
Un sentiment qui résulte de la propagande du Kremlin mais également du nationalisme populaire russe et de l’hostilité envers les Occidentaux enracinée de longue date dans l’opinion publique russe.
Si l’Occident est globalement unanime pour approuver les sanctions infligées à la Russie, certains pays ont un avis plus mesuré sur la question. Peuvent-ils peser dans la balance et influer sur le cours de ce conflit ?
À court terme non, à moyen terme certainement.
Les Occidentaux sont solidaires dans leur stratégie de sanction et dans leur opposition à la remise en question des frontières en Europe. Je dois souligner que pour affronter les défis de cette guerre, les Européens ont été remarquables d’unité, de réalisme. Ils ont actionné tous les leviers d’influence à leur disposition.
Mais leur position ne fait pas l’unanimité sur le plan international. Plus précisément, en Afrique et en Asie. En Afrique, cela se comprend en raison des nombreuses coopérations minières, alimentaires, agricoles qui existent entre plusieurs États et la Russie. S’agissant de l’Asie, il faut remonter à la Guerre froide pour comprendre les réseaux d’alliance tissés avec la Chine et l’Inde.
Le rapport de force ne sera pas infléchi par des pays tiers à la fois éloignés et qui n’ont pas de présence militaire sur place. À plus long terme, aussi bien les géants asiatiques que les pays africains pourront constituer des débouchés pour la Russie et modifier les rapports de force internationaux.