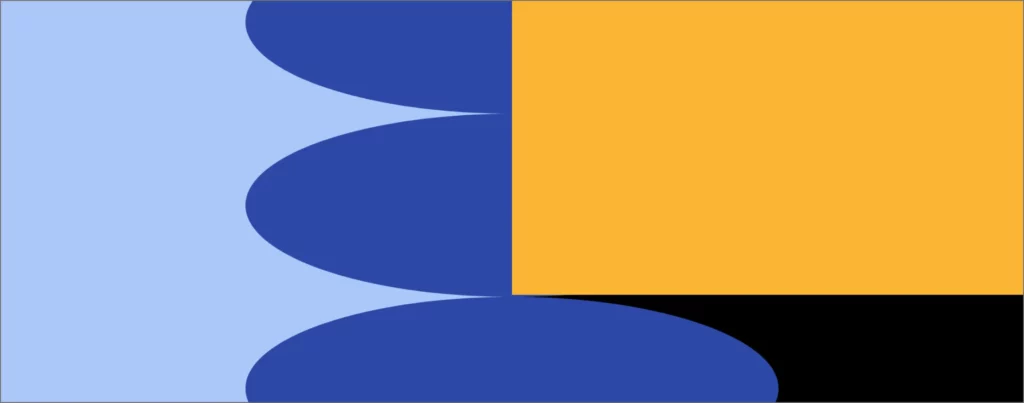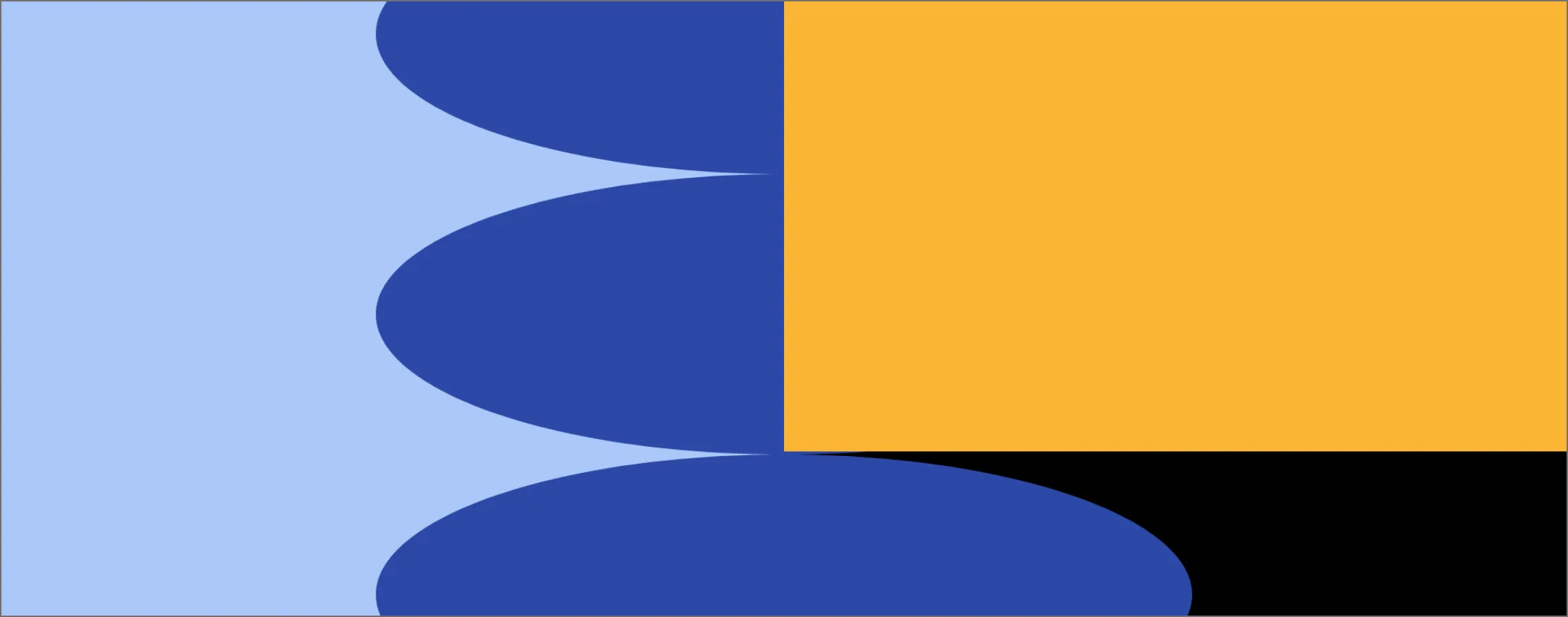Qu’est-ce que le fait divers ?
ll en existe plusieurs définitions. Le fait divers peut se rapporter à une large catégorie, que l’on pourrait résumer à un évènement singulier qui arrive généralement à des personnes inconnues. Il s’agit d’une information extraordinaire, qui peut être négative avec une dimension dramatique, ou bien plus légère, surprenante ou joyeuse. Dans tous les cas il y a une bascule qui vient rompre le quotidien.
Est-il un phénomène médiatique contemporain ?
Non, le fait divers existait même bien avant les médias d’information ! Il a toujours circulé via les supports de communication de son époque, en commençant par la voie orale. L’apparition des occasionnels et notamment des « canards » aux XVe et XVIe siècles, puis des périodiques au XVIIe siècle en France marque son institutionnalisation comme genre journalistique bénéficiant d’une rubrique dédiée. Néanmoins, le terme « fait divers » apparait seulement dans le journal en 1830. Sa naissance officielle est donc liée à l’avènement de la presse écrite, à la suite de quoi chaque media s’en est emparé pour le raconter sous différents formats, radiophoniques puis télévisés.
Les technologies permettent une démultiplication des canaux de communication depuis la fin du XXe siècle. Comment cela influe-t-il sur la circulation des faits divers ?
Il est particulièrement intéressant d’observer comment le contenu évolue avec les formats qui le portent, les deux étant étroitement liés. Le fait divers a une bonne capacité d’étoilement et de propagation du fait de l’accessibilité de ses sujets, qui traitent d’émotions humaines et présentent des histoires à rebondissements, souvent avec une dimension spectaculaire. Tous les ingrédients sont réunis pour fasciner, et donc les nouveaux formats de contenus en ligne peuvent aisément s’en saisir. On trouve ainsi sur des plateformes comme Netflix quantité de séries et documentaires adaptés de faits divers, mais également des podcasts sur les plateformes d’écoute et des youtubeurs désormais spécialisés sur cette typologie de contenu. L’universitaire Philippe Marion parle de “transmédiagénie” pour décrire ce genre de récits qui réussit à se diffuser sous différentes formes en fonction des moyens techniques disponibles.
Comment se fait-il que le fait divers passionne autant, et ce de manière durable dans le temps ?
C’est le caractère humain du fait divers qui attire. Les évènements en question sont chargés d’émotions universelles comme la jalousie et la cupidité. Elles entraînent chez l’audience une identification forte, qui se voit renforcée lorsque que ce sont des personnes inconnues, “normales et comme tout le monde”, qui en sont au cœur. On peut même parler de dimension anthropologique, car les faits divers racontent l’être humain en société, la cohabitation parfois difficile entre individus, et questionnent les limites de l’humanité. Ils racontent donc aussi les sociétés elles-mêmes, leurs mœurs, règles et valeurs ; ainsi selon les pays et les époques des subtilités les distinguent. Ils reposent cependant toujours sur les mêmes grandes trames de fond.
S’il perdure, cela signifie-t-il qu’il remplit une fonction sociale ? Qu’il nous est utile pour faire société ?
Oui, dans un premier temps le discours journalistique rappelle les règles sociales, il agit comme un rappel à l’ordre des normes auxquelles nous sommes tenus dans notre société. C’est aussi une mise en garde face aux dangers qui nous entourent, une invitation à rester vigilant.
Dans un second temps, arrivent l’enquête puis le procès. Ce qui est parfois compliqué à ce niveau, c’est que le temps médiatique et le temps judiciaire sont sur deux vitesses très différentes. Le premier est dans la réaction à chaud et hautement émotionnelle, l’autre s’étale sur des mois voire des années et se veut factuel. Et lorsque le coupable n’est pas retrouvé, c’est toute la capacité de nos institutions à faire justice qui se voit questionnée.
Le fait divers présente-t-il un risque sociétal, politique, ou à l’inverse est-ce un divertissement purement récréatif et inoffensif ?
Tout dépend de la place qui lui est donné dans le récit médiatique. Il faut garder en tête que les faits divers sont des évènements qui sortent de l’ordinaire et donc qu’ils ne sont, par définition, pas communs. Une attention excessive ou une surconsommation donne une vision parcellaire et donc erronée de la société, concentrée sur ses dérives, manquements et dysfonctionnements qui fait courir le risque d’une paranoïa générale. Et il est certain qu’une société gouvernée par la peur ne donne jamais rien de bon ! L’enjeu se fait donc aussi au niveau du travail journalistique, qui doit leur accorder la juste place.
On constate que lorsque ces histoires sont racontées dans d’autres espaces que ceux des actualités, comme les plateformes d’écoute audio ou vidéos, cela leur confère une considération et donc une réception différente. Parce qu’elles sont sur une plateforme dédiée au divertissement, à la détente, et parce que ce sont les individus eux-mêmes qui font le choix d’aller consommer ces contenus, et non un média qui l’impose comme sujet prioritaire. Le cadre de lecture a un impact sur la réception, on n’est pas dans les mêmes conditions quand on allume Netflix que quand on écoute la radio en allant au travail à 8h du matin. Le JT c’est une fenêtre sur le monde, et d’ailleurs toute son esthétique est tournée vers ça. En revanche Netflix propose sur sa page d’accueil à la fois des contenus tirés de faits réels que de la fiction ; tout est mélangé et la temporalité est aussi différente car il existe une latence entre un évènement et son adaptation en documentaire par exemple.
« Une attention excessive ou une surconsommation des faits divers donne une vision parcellaire et donc erronée de la société (...). L’enjeu se fait donc aussi au niveau du travail journalistique, qui doit leur accorder la juste place. »
Bérénice Mariau, maîtresse de conférences en Sciences de l'information et de la communication
Les meurtres, les procès, les accidents de voiture sont fréquents. Qu’est-ce qui fait que certains faits divers deviennent viraux ?
Il existe une multitude de paramètres qui font prendre de l’ampleur à certains faits divers, les faisant passer de l’anecdote à la viralité.
Le premier d’entre eux, c’est lorsque qu’il ne s’agit pas d’un fait divers mais en réalité d’un phénomène de société, c’est-à-dire assez fréquent pour traduire un dysfonctionnement sociétal et non un fait isolé. C’est le cas du meurtre des femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints, désormais qualifié de féminicide, ou par exemple de l’assassinat de Georges Floyd qui s’inscrit dans une longue lignée de crimes raciaux. Mais attention, la frontière entre fait divers et phénomène de société est fine. Souvenons-nous du terme de “francocide” formulé par Éric Zemmour, qui avait voulu par cet élément de langage imposer l’idée selon laquelle le meurtre d’innocentes personnes par des individus d’origine étrangère en raison de leur nationalité française était une pratique récurrente, au point de mériter une terminologie – et une politique répressive ! – spécifique.
Le deuxième paramètre relève de la temporalité : il peut y avoir une série d’évènements similaires se produisant dans un temps rapproché, créant un effet de répétition qui semble faire sens – à tort ou à raison.
Enfin les caractéristiques de la victime comptent également pour beaucoup. Les femmes (hors féminicide) et les enfants émeuvent davantage, car considérés comme vulnérables ; il serait donc d’autant plus lâche et révoltant de s’en prendre à eux. La diffusion de leur photo accentue souvent l’émoi collectif. Même observation en cas d’atteinte aux personnes exerçant des fonctions d’intérêt public. Il en va ainsi des infirmières, des policiers, ou encore des quelques chauffeurs de bus agressés par des passagers refusant d’obéir à la demande de porter un masque sanitaire lors de la pandémie du Covid 19. Ce sont des métiers qui génèrent de la sympathie et donc de l’empathie, car ils contribuent au bon fonctionnement de la société. Ils en constituent un rouage essentiel, auquel s’attaquer semble intolérable.
La récupération politique est-elle systématique ? Pourquoi est-il jugé opportun par les partis ou personnalités politiques de se saisir de ces événements ?
La récupération politique arrive lorsque l’idéologie d’une personnalité ou d’un parti repose sur certaines thématiques, comme l’insécurité. S’il s’agit parfois d’opportunisme électoral, voire de populisme, avec des conclusions tirées très rapidement à partir de faits isolés ou détournés de leur contexte, la politisation d’un fait divers se révèle parfois opportune. Par exemple un accident de cycliste peut être l’occasion de questionner l’aménagement de l’espace urbain pour faciliter la circulation des vélos en toute sécurité. Il en va de même pour la jurisprudence.
On dit que nos sociétés sont de plus en plus gouvernées par les émotions, est-ce que cela laisse présager une inflation du fait divers ?
Les médias sont soumis à des contraintes économiques, les chiffres d’audience guident la plupart des décisions des rédactions. Or les faits divers suscitent de l’intérêt auprès du public. La tentation pour les chaînes d’information d’y consacrer un temps d’antenne important est donc certaine. On citera BFM TV dont l’audience avait explosé lors de l’affaire Pierre Palmade, et qui a alors tenté de créer l’évènement autour de la sortie de prison de l’humoriste, déployant sur place des moyens techniques et humains excessifs, dans l’espoir de retrouver le même niveau d’audimat. Sauf qu’il n’y avait absolument rien à en dire ! Mais la plupart des chaînes essaient néanmoins de doser avec modération la place qui leur est consacrée, gardant en tête un objectif de pluralité et d’éveil des citoyennes et citoyens.
Que l’émotion soit de plus en plus présente, c’est difficile à dire, mais en tout cas il est certain que dans notre écosystème médiatique actuel, où l’interaction et la réaction des publics compte, les évènements comme les faits divers ont de beaux jours devant eux !